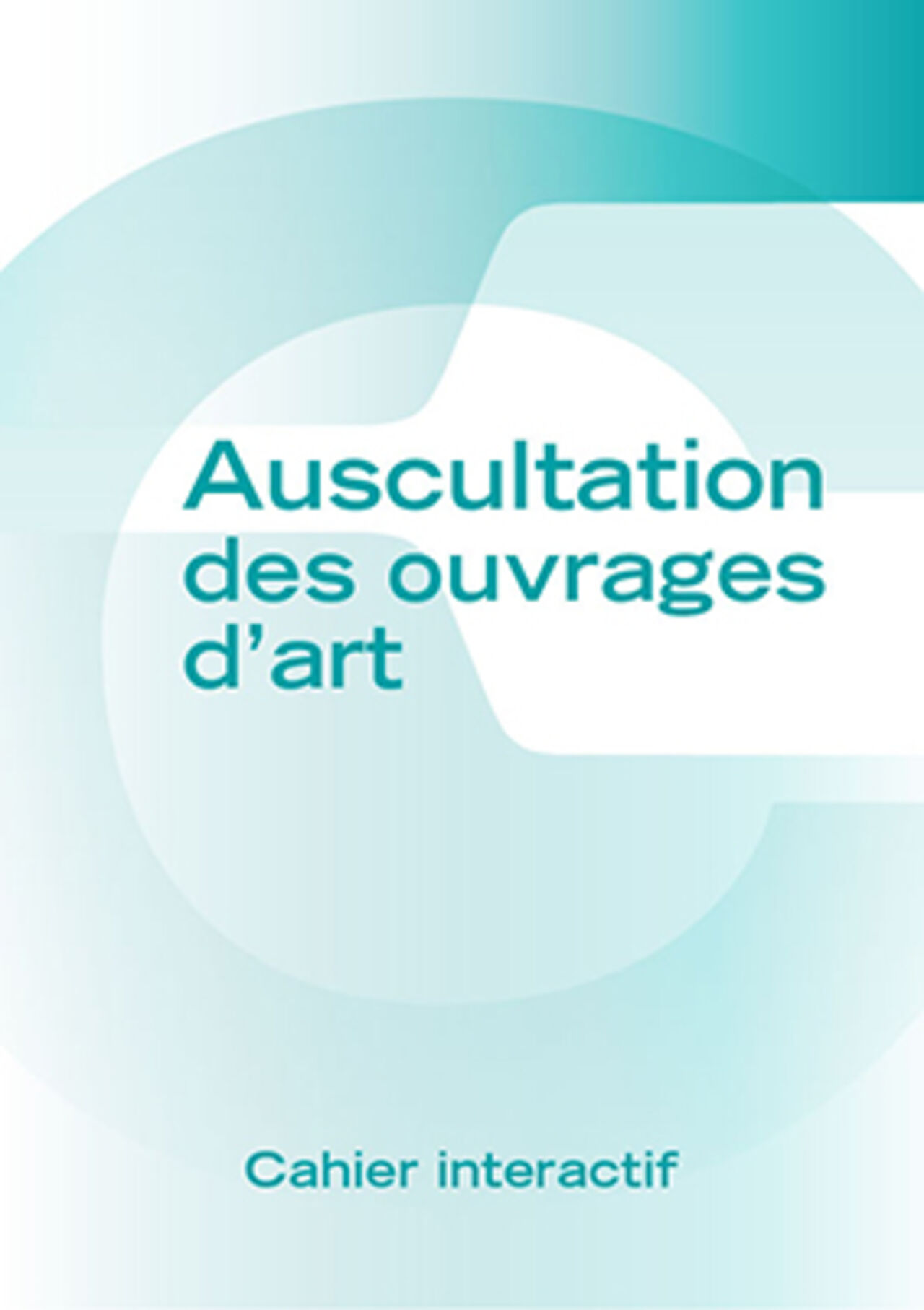
Nature des investigations
Il n'existe pas de méthodologie générale d'auscultation applicable à tous les ouvrages d’art. Les explications recherchées, donc les méthodes d’auscultation à utiliser, diffèrent suivant la nature des désordres constatés. On a l’habitude de distinguer les investigations selon qu’elles s’intéressent au matériau ou à la structure :
- apprécier l’état ou les propriétés des matériaux en place, (matériaux constitutifs de l’ouvrage et/ou des terrains avoisinants) ;
- analyser le mode de fonctionnement réel de la structure ou d’un de ses éléments, à vide et/ou sous chargements.
C’est le pré-diagnostic qui permet de s’orienter vers des méthodes d’auscultation du matériau ou de la structure. Mais, assez souvent, ces deux natures d’investigations existent dans une même campagne d'auscultation. En effet, il peut arriver qu'une défectuosité du matériau ait une incidence directe sur le fonctionnement de la structure (exemple de la corrosion d’armatures de précontrainte qui entraîne une fissuration de la structure). Inversement, le mauvais fonctionnement d'un ouvrage pour des raisons structurelles peut se manifester par une détérioration, au moins partielle, de certains des matériaux constitutifs (cas du tassement d’une culée d’un pont en arc encastré à ses extrémités qui provoque un éclatement du béton en extrados par excès de compression à la naissance de l’arc, cet éclatement étant d’ailleurs associé à une fissuration du béton en intrados).
Les méthodes pour ausculter les matériaux sont plus nombreuses et plus diversifiées que celles pour ausculter les structures. Elles sont aussi généralement plus riches d’informations, surtout si l’on considère qu’il n’existe aucune méthode d’auscultation structurelle pour répondre à la question essentielle qui se pose pour une structure qui est d’évaluer sa capacité portante.
Enfin, une troisième nature d’investigations concerne la surveillance métrologique qui constitue une aide au diagnostic et surtout au pronostic en identifiant et quantifiant l’évolution des phénomènes par des mesures au cours du temps.
Moyens d’auscultation de l’état des matériaux
Les moyens permettant d'apprécier l'état des matériaux comprennent :
- les études et analyses sur prélèvements,
- les techniques d'examen des matériaux en place, soit simples, soit plus raffinées et plus performantes (radiographie, auscultation sonique, auscultation électromagnétique, méthodes électrochimiques, ...).
La première catégorie de moyen est très intéressante car elle fournit des données quantitatives ou des observations directes ; ces informations ont par contre l’inconvénient d’être ponctuelles. Le prélèvement d’un échantillon sur un ouvrage a l’inconvénient d’être partiellement destructif. Il est donc recommandé d’extraire des échantillons les plus petits possible, en nombre limité, et aux endroits les moins sollicités de la structure.
La deuxième catégorie de moyens que l’on appelle souvent sous le nom d’essais non destructifs (END) ou encore de contrôles non destructifs (CND) présente l’avantage de fournir des informations qualitatives sur la globalité de la structure ; par contre ce sont des méthodes physiques qui fournissent des résultats sous forme de grandeur physique qu’il faut pouvoir ensuite relier à des grandeurs mécaniques ou géométriques pour pouvoir les interpréter utilement.
La conjugaison de ces deux catégories de moyens peut se révéler très intéressante pour l’auscultation. Les méthodes non destructives permettent d’avoir une distribution qualitative des caractéristiques recherchées, ce qui permet ensuite de bien positionner les prélèvements de façon à essayer de balayer l’ensemble de la plage de ces caractéristiques et de les quantifier.
Moyens d’auscultation de l’état de la structure
Les moyens permettant d'apprécier le fonctionnement de la structure sont variés, et il est souvent nécessaire de les associer dans une même auscultation.
On peut distinguer :
- les mesures d'ordre topométrique ou géométrique (évolution du nivellement ou mesure de déformation générale ou de déplacement sous chargement (se reporter au fascicule 04 de la deuxième partie de l’ITSEOA [5]),
- les mesures locales de fonctionnement (mesure de déformation locale, extensométrie, fissurométrie, mesure de contrainte, ...),
- les mesures de forces (Pesée de réaction d’appui, mesure de tension dans les haubans, ...),
- les mesures des facteurs extérieurs influents (température, hygrométrie, niveau d’eau, ...).
L’utilisation de ces moyens techniques et l’interprétation des résultats nécessitent en général le recours à des spécialistes. Il est rappelé que l’intervention conjointe d’un agent spécialisé de laboratoire et d’un agent spécialisé de bureau d’études est très souhaitable dans la plupart des cas, le maître d’oeuvre de la réparation devant toujours y être associé.
Programme d’auscultation
L’auscultation d’un ouvrage d’art doit faire l’objet d’un programme qui en fixe les objectifs généraux, et qui précise la nature des investigations à effectuer. Le programme d’auscultation est généralement établi par le laboratoire ou la société en charge de l’auscultation, puis proposé au gestionnaire de l’ouvrage qui le valide, parfois après consultation de spécialistes ou du bureau d’études.
Les méthodes d’auscultation sont parfois fort coûteuses, et l’une des difficultés de l’établissement d’un bon programme d’auscultation est de procéder à toutes les investigations nécessaires à la détermination des causes des désordres et de leurs mécanismes, ainsi qu’à l’établissement du projet de réparation, tout en évitant les essais et recherches inutiles ou qui ne permettraient pas de répondre aux questions que l’on se pose.
L’établissement du programme doit donc être précédé d’une phase de réflexion, et le programme peut être revu en cours d’exécution, si nécessaire, en fonction des premiers résultats obtenus et de l’interprétation qui peut en être faite.