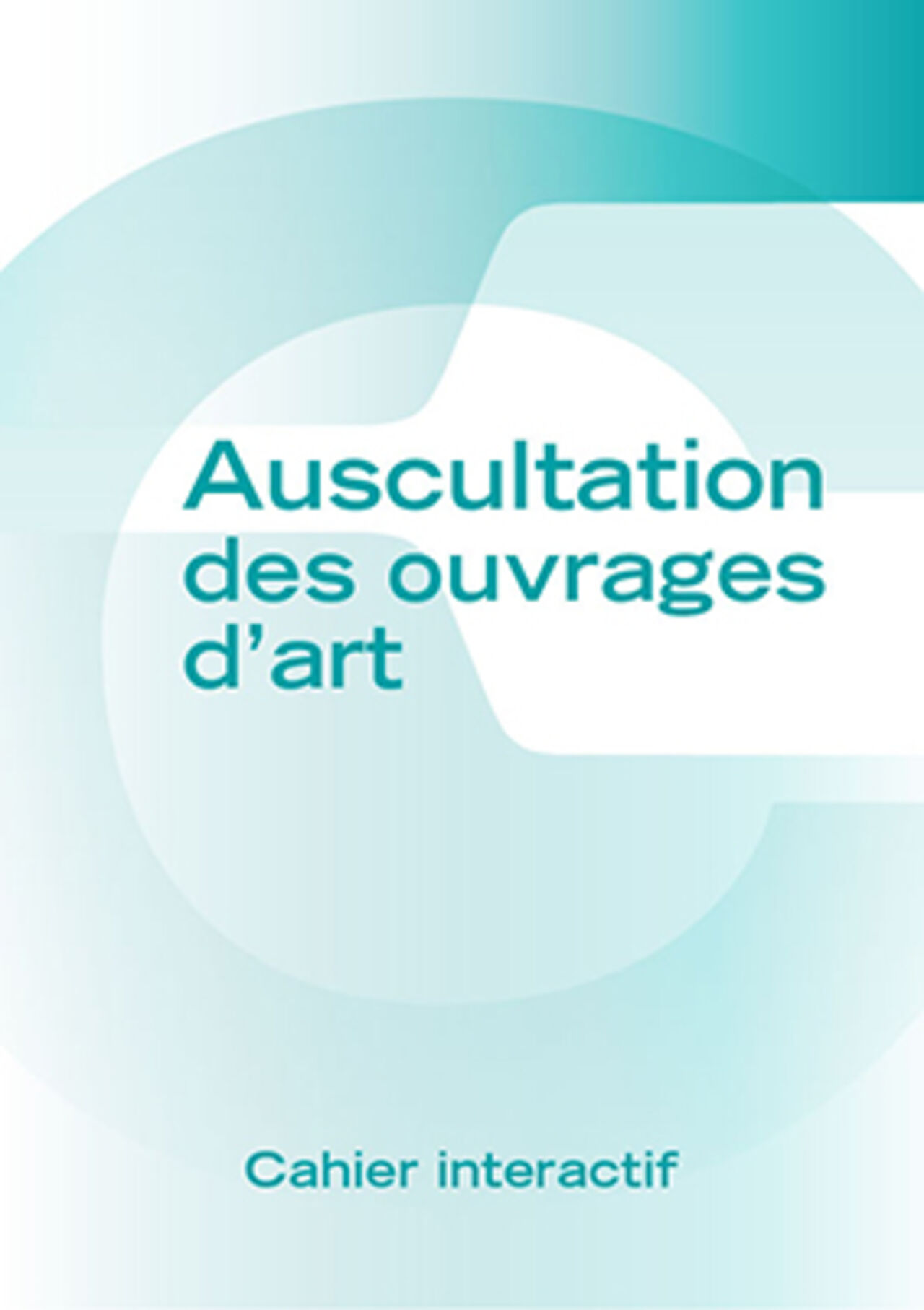
Objectifs de l'auscultation
L’auscultation qui peut concerner à la fois la structure et ses fondations peut avoir plusieurs objectifs parmi lesquels nous retiendrons les trois plus importants :
L’établissement du diagnostic
C’est l’objectif le plus fréquent. Hormis les cas simples où le pré-diagnostic réalisé à l’issue de l’inspection visuelle suffit pour se forger une opinion sur la pathologie affectant un ouvrage, et les cas compliqués où des recherches sont encore nécessaires pour identifier l’origine de la pathologie, des auscultations conduites suivant les règles de l’art doivent permettre d’aboutir au bon diagnostic dont l’obtention est une condition sine qua non avant de s’engager dans une réparation.
L’absence de diagnostic peut aboutir à mettre en oeuvre des solutions de réparation inadaptées au problème à traiter, ou des techniques de réparation qui vont endommager l’ouvrage ou initier de nouvelles pathologies.
L’évaluation de l’ampleur et de la gravité des désordres
Cette évaluation fait souvent appel à une conjugaison de techniques de contrôles non destructifs (généralement qualitatives) et de techniques quantitatives appliquées sur des prélèvements. Lorsque les désordres sont cachés, cette évaluation peut devenir très difficile.
Exemple de la corrosion des armatures : Dans le cas du béton armé, la méthode du potentiel d’électrode permet d’obtenir une bonne image du risque de corrosion des aciers. Dans le cas du béton précontraint, et plus particulièrement des VIPP (Viaducs Indépendants à Poutres Précontraintes), il n’existe à l’heure actuelle aucune méthode qui permette d’avoir une vision globale de l’état de corrosion des câbles de précontrainte, et ce dernier ne peut être estimé qu’au prix de l’ouverture de plusieurs fenêtres dont l’emplacement aura été guidé par des techniques d’investigation non destructives décrites dans le cahier interactif.
La détermination de l’ampleur et de la gravité des désordres est parfois indispensable pour pouvoir choisir la technique de réparation et pour déterminer les conditions de sécurité lors des travaux.
Exemple des dégradations superficielles dues à la corrosion des armatures de béton armé : selon l’étendue de ces dégradations on choisira, soit la technique du ragréage si les éclatements de béton sont localisés, soit la technique de réparation par béton projeté si les surfaces à réparer sont très étendues.
Exemple des désordres structurels présentés par un pont en béton armé : selon la gravité des désordres, on s’orientera vers un renforcement par armatures passives ou vers un renforcement par précontrainte.
La définition ou la confirmation d’hypothèses de calcul
Cet objectif répond aux vœux du bureau d’études qui a en charge, dans le cadre d’un diagnostic, le recalcul d’évaluation structurale et qui souhaite approcher dans ses calculs le comportement réel de la structure. La détermination de caractéristiques mécaniques des matériaux constitue un cas courant avec notamment la résistance à la compression et le module de déformation du béton, ainsi que la limite d’élasticité et la limite à rupture du métal.
D’autres données issues de l’auscultation peuvent être également intéressantes pour confirmer la pertinence des modèles de calcul. On peut citer, par exemple, la vérification de la rotation effective d’articulations, la connaissance des réactions d’appui, la vérification du fonctionnement mixte d’une section acier-béton, la flèche prise par une travée sous un chargement donné, la vérification du fonctionnement transversal d’un tablier à poutres sous chaussées.
Si ces paramètres peuvent être évalués sans trop de difficultés, il existe par contre d’autres caractéristiques comme l’adhérence entre une armature et du béton ou la valeur globale de la résistance résiduelle d’une précontrainte corrodée qui sont impossibles à obtenir dans l’état actuel des techniques d’auscultation.
Cet objectif est également très fréquent pour confirmer les hypothèses à retenir pour les sols environnants, ces dernières intervenant dans le calcul des soutènements et fondations. On peut citer, par exemple, la connaissance du niveau de la nappe phréatique, la reconnaissance de la géométrie des fondations, les caractéristiques mécaniques des sols que ce soit pour leur action extérieure sur les structures ou leur contribution à la résistance de la structure (fondation, interaction sol-structure).